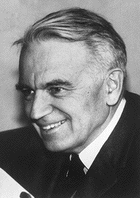
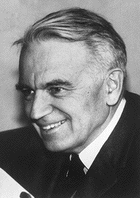
Physico-chimiste canadien d’origine allemande né à Hambourg. Gerhard Herzberg effectue ses études à l’université technique de Darmstadt, où il obtient un doctorat en 1924. Il séjourne ensuite à Göttingen et à Bristol, puis retourne à Darmstadt, où il est nommé Privatdozent (chargé de cours) en 1930. Chassé d’Allemagne par les lois racistes du régime nazi, il obtient, en 1935, à l’université du Saskatchewan au Canada, un poste de directeur de recherches qu’il va occuper jusqu’en 1945. À cette date, il accepte un poste à l’observatoire Yerkes de l’université de Chicago pour y créer un laboratoire de spectroscopie. En 1947, il revient au Conseil national de la recherche du Canada, au sein duquel il est nommé, en 1949, directeur de la division de la physique, poste qu’il va occuper pendant vingt ans. À son départ en retraite, en 1969, il occupe un poste spécialement créé à son intention pour lui permettre de continuer ses activités de recherches sans limitation de durée et sans charges administratives.
Herzberg a consacré sa carrière à l’étude de la spectroscopie des atomes et des molécules. Il détermine ainsi les niveaux d’énergie de molécules diatomiques et polyatomiques et obtient des informations précises sur la géométrie de ces espèces. Dans ses premiers travaux à Darmstadt, Herzberg interprète ses observations spectroscopiques dans le cadre de la mécanique ondulatoire: il peut ainsi, avant la découverte du neutron, montrer que la statistique de Bose-Einstein s’applique au noyau de N2, qui ne doit donc pas comporter d’électrons. Dans les années 1930, il s’intéresse à la spectroscopie infrarouge et aux espèces présentes dans l’espace interstellaire et dans l’atmosphère des comètes et des étoiles. De retour au Canada en 1947, il fait construire au laboratoire d’Ottawa des spectrographes à haute résolution et développe les techniques de photolyse et de radiolyse qui vont permettre, grâce à des cellules spécialement adaptées, l’étude de radicaux libres de durées de vie extrêmement courtes. Il peut ainsi étudier plus d’une trentaine de radicaux libres, dont un grand nombre provenant de l’atmosphère de planètes, de poussières interstellaires et de comètes. Herzberg a reçu en 1971 le prix Nobel de chimie.